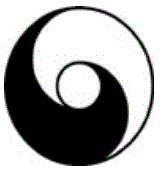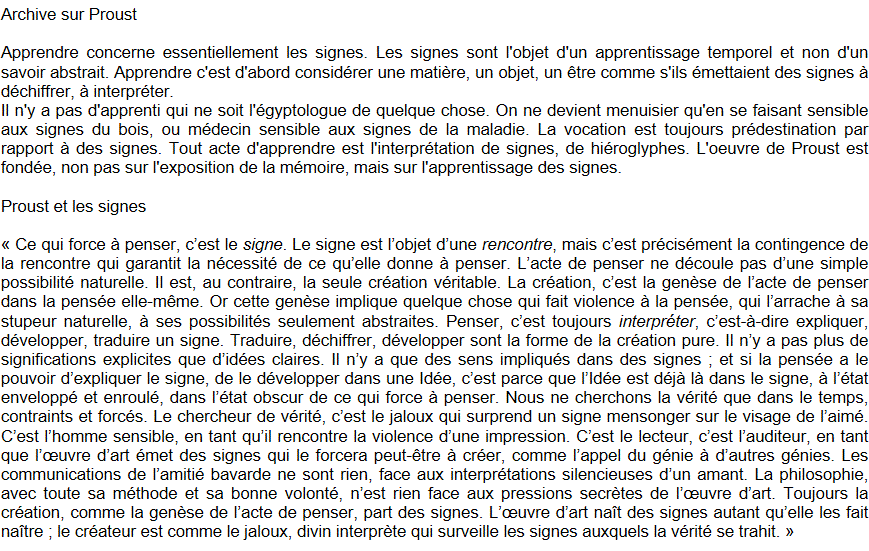|
|
Deleuze - Courts extraits
Pour Deleuze, la philosophie consiste à usiner des concepts. Pour lui, un concept est une multiplicité, une surface, un volume absolu autoréférent composé de certaines variations intensives inséparables suivant un ordre de voisinage et parcouru par un point en état de survol. Le concept est le contour, la configuration, la constellation d'un événement à venir. [...] Les concepts ne sont jamais séparables de deux autres choses : des affects et des percepts.
|
Ecrire c'est forcément pousser le langage jusqu'à une certaine limite.
Le grand traducteur, loin d'être celui qui est aussi fidèle que possible à l'original, est celui qui saisit la façon de faire, la façon d'avancer du texte.
Propos sur la communication et l'information - 1987
En un premier sens on peut dire que la communication est la transmission et la propagation d'une information. Or, une information est un ensemble de mots d'ordre. Quand on vous informe, on vous dit ce que vous êtes censé devoir croire. En d'autres termes, informer c'est faire circuler un mot d'ordre. Les informations de police sont dites à juste titre des communiqués. On nous communique de l'information, c'est à dire on nous dicte ce qu'on est censé être en état ou devoir croire. Ou même pas de croire, mais de faire comme si on croyait; puisqu'on nous demande seulement de nous comporter comme si on croyait. Indépendamment de ces mots d'ordre et de la transmission de ces mots d'ordre, il n'y a pas de communication, pas d'information si bien que l'information est le système du contrôle.
|
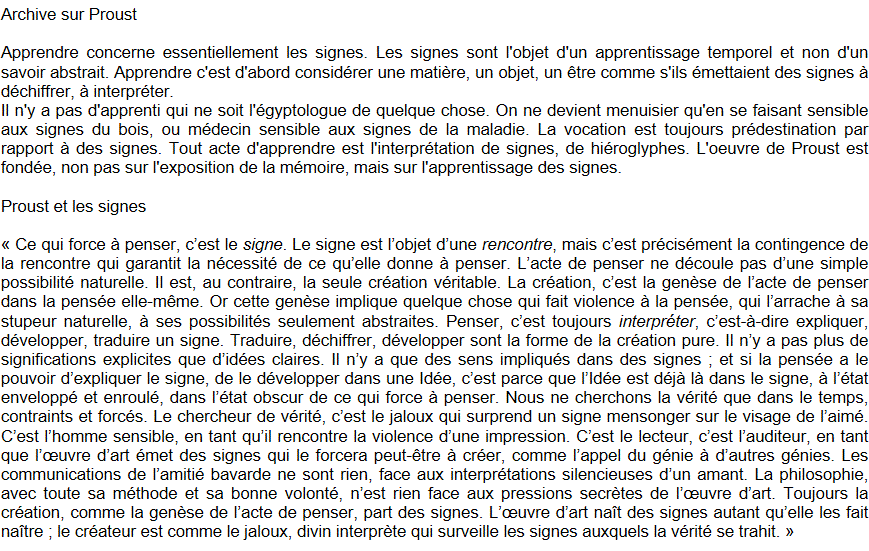
Propos sur la joie
Qu'est-ce que la ligne de joie
? La joie, c'est tout ce qui s'enchaine à partir de ma rencontre avec un corps qui convient avec le mien. Donc, ce corps qui convient avec le mien, je l'aime. De même que la haine découlait de la tristesse, l'amour découle de la joie.
Post-scriptum sur les sociétés de contrôle
Historique
Foucault a situé les sociétés disciplinaires aux XVIIIème et XIXème siècles ; elles atteignent à leur apogée au début du XXème siècle. Elles procèdent à l'organisation des grands milieux d'enfermement. L'individu ne cesse de passer d'un milieu clos à un autre, chacun ayant ses lois : d'abord la famille, puis l'école (« tu n'es plus dans ta famille »), puis la caserne (« tu n'es plus à l'école »), puis l'usine, de temps en temps l'hôpital, éventuellement la prison qui est le milieu d'enfermement par excellence. C'est la prison qui sert de modèle analogique : l'héroïne d'Europe 51 peut s'écrier quand elle voit des ouvriers « j'ai cru voir des condamnés... ». Foucault a très bien analysé le projet idéal des milieux d'enfermement, particulièrement visible dans l'usine : concentrer ; répartir dans l'espace ; ordonner dans le temps ; composer dans l'espace-temps une force productive dont l'effet doit être supérieur à la somme des forces élémentaires. Mais ce que Foucault savait aussi, c'était la brièveté de ce modèle : il succédait à des sociétés de souveraineté, dont le but et les fonctions étaient tout autres (prélever plutôt qu'organiser la production, décider de la mort plutôt que gérer la vie) ; la transition s'était faite progressivement, et Napoléon semblait opérer la grande conversion d'une société à l'autre. Mais les disciplines à leur tour connaîtraient une crise, au profit de nouvelles forces qui se mettraient lentement en place, et qui se précipiteraient après la Deuxième Guerre mondiale : les sociétés disciplinaires, c'était déjà ce que nous n'étions plus, ce que nous cessions d'être.
Nous sommes dans une crise généralisée de tous les milieux d'enfermement, prison, hôpital, usine, école, famille. La famille est un « intérieur », en crise comme tout autre intérieur, scolaire, professionnel, etc. Les ministres compétents n'ont cessé d'annoncer des réformes supposées nécessaires. Réformer l'école, réformer l'industrie, l'hôpital, l'armée, la prison ; mais chacun sait que ces institutions sont finies, à plus ou moins longue échéance. Il s'agit seulement de gérer leur agonie et d'occuper les gens, jusqu'à l'installation de nouvelles forces qui frappent à la porte. Ce sont les sociétés de contrôle qui sont en train de remplacer les sociétés disciplinaires. « Contrôle », c'est le nom que Burroughs propose pour désigner le nouveau monstre, et que Foucault reconnaît comme notre proche avenir. Paul Virilio aussi ne cesse d'analyser les formes ultra-rapides de contrôle à l'air libre, qui remplacent les vieilles disciplines opérant dans la durée d'un système clos. Il n'y a pas lieu d'invoquer des productions pharmaceutiques extraordinaires, des formations nucléaires, des manipulations génétiques, bien qu'elles soient destinées à intervenir dans le nouveau processus. Il n'y a pas lieu de demander quel est le régime le plus dur, ou le plus tolérable, car c'est en chacun d'eux que s'affrontent les libérations et les asservissements. Par exemple dans la crise de l'hôpital comme milieu d'enfermement, la sectorisation, les hôpitaux de jour, les soins à domicile ont pu marquer d'abord de nouvelles libertés, mais participer aussi à des mécanismes de contrôle qui rivalisent avec les plus durs enfermements. Il n'y a pas lieu de craindre ou d'espérer, mais de chercher de nouvelles armes.
Logique
Les différents internats ou milieux d'enfermement par lesquels l'individu passe sont des variables indépendantes : on est censé chaque fois recommencer à zéro, et le langage commun de tous ces milieux existe, mais est analogique. Tandis que les différents contrôlats sont des variations inséparables, formant un système à géométrie variable dont le langage est numérique (ce qui ne veut pas dire nécessairement binaire). Les enfermements sont des moules, des moulages distincts, mais les contrôles sont une modulation, comme un moulage auto-déformant qui changerait continûment, d'un instant à l'autre, ou comme un tamis dont les mailles changeraient d'un point à un autre. On le voit bien dans la question des salaires : l'usine était un corps qui portait ses forces intérieures à un point d'équilibre, le plus haut possible pour la production, le plus bas possible pour les salaires ; mais, dans une société de contrôle, l'entreprise a remplacé l'usine, et l'entreprise est une âme, un gaz. Sans doute l'usine connaissait déjà le système des primes, mais l'entreprise s'efforce plus profondément d'imposer une modulation de chaque salaire, dans des états de perpétuelle métastabilité qui passent par des challenges, concours et colloques extrêmement comiques. Si les jeux télévisés les plus idiots ont tant de succès, c'est parce qu'ils expriment adéquatement la situation d'entreprise. L'usine constituait les individus en corps, pour le double avantage du patronat qui surveillait chaque élément dans la masse, et des syndicats qui mobilisaient une masse de résistance ; mais l'entreprise ne cesse d'introduire une rivalité inexpiable comme saine émulation, excellente motivation qui oppose les individus entre eux et traverse chacun, le divisant en lui-même. Le principe modulateur du « salaire au mérite » n'est pas sans tenter l'Éducation nationale elle-même : en effet, de même que l'entreprise remplace l'usine, la formation permanente tend à remplacer l'école, et le contrôle continu remplacer l'examen. Ce qui est le plus sûr moyen de livrer l'école à l'entreprise.
Dans les sociétés de discipline, on n'arrêtait pas de recommencer (de l'école à la caserne, de la caserne à l'usine), tandis que dans les sociétés de contrôle on n'en finit jamais avec rien, l'entreprise, la formation, le service étant les états métastables et coexistants d'une même modulation, comme d'un déformateur universel. Kafka qui s'installait déjà à la charnière de deux types de société a décrit dans Le procès les formes juridiques les plus redoutables : l'acquittement apparent des sociétés disciplinaires (entre deux enfermements), l'atermoiement illimité des sociétés de contrôle (en variation continue) sont deux modes de vie juridiques très différents, et si notre droit est hésitant, lui-même en crise, c'est parce que nous quittons l'un pour entrer dans l'autre. Les sociétés disciplinaires ont deux pôles : la signature qui indique l'individu, et le nombre ou numéro matricule qui indique sa position dans une masse. C'est que les disciplines n'ont jamais vu d'incompatibilité entre les deux, et c'est en même temps que le pouvoir est massifiant et individuant, c'est-à-dire constitue en corps ceux sur lesquels il s'exerce et moule l'individualité de chaque membre du corps (Foucault voyait l'origine de ce double souci dans le pouvoir pastoral du prêtre - le troupeau et chacune des bêtes - mais le pouvoir civil allait se faire « pasteur » laïc à son tour avec d'autres moyens). Dans les sociétés de contrôle, au contraire, l'essentiel n'est plus une signature ni un nombre, mais un chiffre : le chiffre est un mot de passe, tandis que les sociétés disciplinaires sont réglées par des mots d'ordre (aussi bien du point de vue de
l'intégration que de la résistance). Le langage numérique du contrôle est fait de chiffres, qui marquent l'accès à l'information, ou le rejet. On ne se trouve plus devant le couple masse-individu. Les individus sont devenus des « dividuels », et les masses, des échantillons, des données, des marchés ou des « banques ». C'est peut-être l'argent qui exprime le mieux la distinction des deux sociétés, puisque la discipline s'est toujours rapportée à des monnaies moulées qui renfermaient de l'or comme nombre étalon, tandis que le contrôle renvoie à des échanges flottants, modulations qui font intervenir comme chiffre un pourcentage de différentes monnaies échantillons. La vieille taupe monétaire est l'animal des milieux d'enfermement, mais le serpent est celui des sociétés de contrôle. Nous sommes passés d'un animal à l'autre, de la taupe au serpent, dans le régime où nous vivons, mais aussi dans notre manière de vivre et nos rapports avec autrui. L 'homme des disciplines était un producteur discontinu d'énergie, mais l'homme du contrôle est plutôt ondulatoire, mis en orbite, sur faisceau continu. Partout le surf a déjà remplacé les vieux sports.
Il est facile de faire correspondre à chaque société des types de machines, non pas que les machines soient déterminantes, mais parce qu'elles expriment les formes sociales capables de leur donner naissance et de s'en servir. Les vieilles sociétés de souveraineté maniaient des machines simples, leviers, poulies, horloges ; mais les sociétés disciplinaires récentes avaient pour équipement des machines énergétiques, avec le danger passif de l'entropie, et le danger actif du sabotage ; les sociétés de contrôle opèrent par machines de troisième espèce, machines informatiques et ordinateurs dont le danger passif est le brouillage, et l'actif, le piratage et l'introduction de virus. Ce n'est pas une évolution technologique sans être plus profondément une mutation du capitalisme. C'est une mutation déjà bien connue qui peut se résumer ainsi : le capitalisme du XIXè siècle est à concentration, pour la production, et de propriété. Il érige donc l'usine en milieu d'enfermement, le capitaliste étant propriétaire des moyens de production, mais aussi éventuellement propriétaire d'autres milieux conçus par analogie (la maison familiale de l'ouvrier, l'école). Quant au marché, il est conquis tantôt par spécialisation, tantôt par colonisation, tantôt par abaissement des coûts de production. Mais, dans la situation actuelle, le capitalisme n'est plus pour la production, qu'il relègue souvent dans la périphérie du tiers monde, même sous les formes complexes du textile, de la métallurgie ou du pétrole. C'est un capitalisme de surproduction. Il n'achète plus des matières premières et ne vend plus des produits tout faits : il achète les produits tout faits, ou monte des pièces détachées. Ce qu'il veut vendre, c'est des services, et ce qu'il veut acheter, ce sont des actions. Ce n'est plus un capitalisme pour la production, mais pour le produit, c'est-à-dire pour la vente ou pour le marché. Aussi est-il essentiellement dispersif, et l'usine a cédé la place à l'entreprise. La famille, l'école, l'armée, l'usine ne sont plus des milieux analogiques distincts qui convergent vers un propriétaire, État ou puissance privée, mais les figures chiffrées, déformables et transformables, d'une même entreprise qui n'a plus que des gestionnaires. Même l'art a quitté les milieux clos pour entrer dans les circuits ouverts de la banque. Les conquêtes de marché se font par prise de contrôle et non plus par formation de discipline, par fixation des cours plus encore que par abaissement des coûts, par transformation de produit plus que par spécialisation de production. La corruption y gagne une nouvelle puissance. Le service de vente est devenu le centre ou l'« âme » de l'entreprise. On nous apprend que les entreprises ont une âme, ce qui est bien la nouvelle la plus terrifiante du monde. Le marketing est maintenant l'instrument du contrôle social, et forme la race impudente de nos maîtres. Le contrôle est à court terme et à rotation rapide, mais aussi continu et illimité, tandis que la discipline était de longue durée, infinie et discontinue. L'homme n'est plus l'homme enfermé, mais l'homme endetté. Il est vrai que le capitalisme a gardé pour constante l'extrême misère des trois quarts de l'humanité, trop pauvres pour la dette, trop nombreux pour l'enfermement : le contrôle n'aura pas seulement à affronter les dissipations de frontières, mais les explosions de bidonvilles ou de ghettos.
Programme
Il n'y a pas besoin de science-fiction pour concevoir un mécanisme de contrôle qui donne à chaque instant la position d'un élément en milieu ouvert, animal dans une réserve, homme dans une entreprise (collier électronique). Félix Guattari imaginait une ville où chacun pouvait quitter son appartement, sa rue, son quartier, grâce à sa carte électronique (dividuelle) qui faisait lever telle ou telle barrière ; mais aussi bien la carte pouvait être recrachée tel jour, ou entre telles heures ; ce qui compte n'est pas la barrière, mais l'ordinateur qui repère la position de chacun, licite ou illicite, et opère une modulation universelle.
L'étude socio-technique des mécanismes de contrôle, saisis à leur aurore, devrait être catégorielle et décrire ce qui est déjà en train de s'installer à la place des milieux d'enfermement disciplinaires, dont tout le monde annonce la crise. Il se peut que de vieux moyens, empruntés aux anciennes sociétés de souveraineté, reviennent sur scène, mais avec les adaptations nécessaires. Ce qui compte, c'est que nous sommes au début de quelque chose. Dans le régime des prisons : la recherche de peines de « substitution » au moins pour la petite délinquance, et l'utilisation de colliers électroniques qui imposent au condamné de rester chez lui à telles heures. Dans le régime des écoles : les formes de contrôle continu, et l'action de la formation permanente sur l'école, l'abandon cotres pondant de toute recherche à l'Université, l'introduction de l' « entreprise » à tous les niveaux de scolarité. Dans le régime des hôpitaux : la nouvelle médecine « sans médecin ni malade » qui dégage des malades potentiels et des sujets à risque, qui ne témoigne nullement d'un progrès vers l'individuation, comme on le dit, mais substitue au corps individuel ou numérique le chiffre d'une matière « dividuelle » à contrôler. Dans le régime d'entreprise : les nouveaux traitements de l'argent, des produits et des hommes qui ne passent plus par la vieille forme-usine. Ce sont des exemples assez minces, mais qui permettraient de mieux comprendre ce qu on entend par crise des institutions, c'est-à-dire l'installation progressive et dispersée d'un nouveau régime de domination. Une des questions les plus importantes concernerait l'inaptitude des syndicats : liés dans toute leur histoire à la lutte contre les disciplines ou dans les milieux d'enfermement, pourront-ils s'adapter ou laisseront-ils place à de nouvelles formes de résistance contre les sociétés de contrôle ? Peut-on déjà saisir des ébauches de ces formes à venir, capables de s'attaquer aux joies du marketing ? Beaucoup de jeunes gens réclament étrangement d'être « motivés », ils redemandent des stages et de la formation permanente ; c'est à eux de découvrir ce à quoi on les fait servir, comme leurs aînés ont découvert non sans peine la finalité des disciplines. Les anneaux d'un serpent sont encore plus compliqués que les trous d'une taupinière.
Transcription d'un cours - citant Nietzsche à propos des affects - 1983
« Il n’y a pas de bons concepts sans un grand amour ». Là, sans un grand amour, ça ne veut pas du tout dire : intéressez vous à ce que vous faites - parce que c’est la moindre des choses - ça veut dire que les concepts ou les pensées que vous avez, quelles qu’elles soient, d’ordre scientifique, d’ordre philosophique, n’importe quel ordre - ne soient pas sans augmenter votre puissance d’exister et sans vous faire percevoir une multiplicité d’autres choses. Alors, l’affect, je le définirais comment ?
- Ce qui augmente ma puissance d’exister. Nietzsche nous donnera la continuation : « c’est ce qui nous rend de plus en plus léger ».
Nietzsche veut nous dire des choses très simples : si vous aimez quelqu’un, si vous aimez quelqu’un, de deux choses l’une - et ce sera pas votre faute - vous en tirerez tristesse, angoisse ; au besoin, est-ce qu’il m’aime ? Est-ce qu’elle m’aime ? Est-ce qu’elle me trompe ? Problème de la vérité : est ce qu’elle me trompe ou pas ? angoisse : dix minutes de retard, tout ça. Antonioni disait : « nous sommes malades d’Eros, nous sommes tous malades d’Eros ». Bref, dans ce cas-là, l’amour diminue votre puissance d’exister. Est-ce qu’il vous fait percevoir de plus en plus de choses ? Ah non ! du matin au soir, comme un abruti, j’exagère, mais enfin, mais ça ne vous rend, non seulement pas très intelligent, mais ça ne nous rend pas percevant, ça ne nous rend pas visionnaire.
Au contraire, même un amour dit malheureux - j’imagine, ce que je dis est nietzschéen, moi , c’est tout à fait nietzschéen, c’est, je sais pas s’il vivait tout à fait comme ça, mais c’est dur de vivre comme ça, il prétendait pas : faut, faut y arriver, très difficile - un amour même malheureux, d’une certaine manière, je suppose, y aurait-il une joie d’aimer ? Aimer quelqu’un, après tout, c’est le trouver bien - c’est être capable de percevoir quelque chose en lui qui n’est pas évident, c’est jamais très évident - mais on est capable de percevoir quelque chose en lui, la question c’est pas de savoir : est-ce que ça existe ou pas, vraiment ?
- J’ai une perception. Qu’est-ce que ça voudrait dire, la perception ? Et bien, je perçois quelque chose, si on me dit : est-ce que ça existe vraiment ? Mais je dis : mais quoi, ça va pas la tête, vraiment ? Ça veut dire que je peux le dessiner comme on dessine la forme d’un nez. Alors on peut me dire : oui, tu, tu dis qu’elle a le nez en trompette, mais elle a au contraire le nez crochu, ça, ça on peut discuter, c’est du solide, c’est de la perspective spatiale. Mais, si un sourire, même adressé à un autre, me donne une espèce de sentiment de perfection. Bon ! on ne va pas vous dire : est-ce que c’est vrai, est-ce que c’est faux ? Je dirais : « mais de quoi tu parles ? qu’est-ce que ça veut dire ? C’est pas la question ».
Je dis que, un tel amour, qui ne me paraît pas insensé après tout, est plutôt content d’aimer, même, si soi, on n’est pas tellement aimé, c’est secondaire. C’est secondaire, non, c’est pas secondaire. Mais enfin, il n’y a pas de quoi en pleurer, tout ça, ça se retrouvera, quoi. Pas de quoi en pleurer, il n’y a pas de quoi en faire un..., il n’y a pas de quoi en être malade, hein ? ça, c’est une forme d’amour qui consiste à augmenter sa puissance d’exister et du coup qui vous rend apte à percevoir de plus en plus de choses, et de gens - et ça veut pas dire forcément, ça ne veut pas dire : multipliez vos amours, mais plus vous aimez quelqu’un, plus vous augmentez votre puissance d’exister, plus vous devenez apte à percevoir des choses, au besoin d’une toute autre nature. Vous me direz : qu’est-ce que c’est que ce discours grotesque sur l’amour ? c’est, c’est pas grave, parce que ça pourrait être autre chose que l’amour, c'est un affect quelconque, vous avez des affects qui diminuent votre puissance d’agir, appelons-les les affects lourds. Vous avez des affects qui augmentent votre puissance d’agir, appelons-les des affects légers.
Nous disons que cela à affaire avec quoi ? Nous disons que cela à affaire avec ce qui est le plus, le plus profond dans la sagesse et dans la sagesse des sagesses, c’est-à-dire le rapport que vous devez avoir et entretenir avec un centre de gravité. Plus vous vous identifierez et plus vous vous localiserez dans vos propres centres de gravités, plus vous serez agile, rapide, plus vous augmenterez votre puissance d’agir, même au prix de déséquilibres, même au prix d’un déséquilibre qu’il faudra perpétuellement compenser, tout ça ; plus vous serez distant de vos centres de gravités, plus vous serez lourd.
Bon, c’est le lourd et le léger lorsque je définis l’affect par rapport au centre de gravité, et là, si je devais me réclamer d’un auteur - ce serait cette fois ci d’un allemand, du romantique allemand Kleist - si vous définissez l’affect par rapport au centre de gravité, voyez que les affects qui tendent à augmenter votre puissance d’agir, c’est les affects légers, les autres c’est les affects de lourdeur, d’où le mot de Nietzsche : « que la terre devienne légère ».
Spinoza philosophie pratique
Chapitre II
Il n'y a pas moins de choses dans l'esprit qui dépassent notre conscience que de choses dans le corps qui dépassent notre connaissance. C'est donc par un seul et même mouvement que nous arriverons, si c'est possible, à saisir la puissance du corps au-delà des conditions données de connaissance et à saisir la puissance de l'esprit au-delà des conditions données de notre conscience. On cherche à acquérir une connaissance des puissances du corps pour découvrir parallèlement les puissances de l'esprit qui échappent à la conscience, et pouvoir comparer les puissances.[...]
La nature [de la conscience] est naturellement le lieu d'une illusion. Sa nature est telle qu'elle recueille des effets mais ignore les causes. L'ordre des causes se définit par ceci : chaque corps dans l'étendue, chaque idée ou chaque esprit dans la pensée sont constitués par des rapports caractéristiques, qui subsument les parties de ce corps, les parties de cette idée... L'ordre des causes est un ordre de composition et de décomposition de rapports qui affecte à l'infini la nature entière... nous recueillons seulement « ce qui arrive » à notre corps, « ce qui arrive » à notre âme, c'est à dire l'effet d'un corps sur le nôtre, l'effet d'une idée sur la nôtre. Mais, ce qu'est notre corps sous son propre rapport, et notre âme sous sont propre rapport, et les autres corps et les autres âmes ou idées sous leurs rapports respectifs, et les règles d'après lesquels ces rapports se composent et se décomposent - tout celà, nous n'en savons rien dans l'ordre donné de notre connaissance et de notre conscience. Bref, les conditions dans lesquelles nous connaissons les choses et prenons conscience de nous mêmes nous condamnent à n'avoir ques des idées inadéquates, confuses et mutilées, effets séparés de leurs propres causes.
Chapitre IV
Les notions communes (Ethique, II, 37-40) ne sont pas ainsi nommées parce qu’elles sont communes à tous les esprits, mais d’abord parce qu’elles représentent quelque chose de commun aux corps : soit à tous les corps (l’étendue, le mouvement et le repos), soit à certains corps (deux au minimum, le mien et un autre). En ce sens, les notions communes ne sont pas du tout des idées abstraites mais des idées générales (elles ne constituent l’essence d’aucune chose singulière, II, 37); et, suivant leur extension, suivant qu’elles s’appliquent à tous les corps ou seulement à certains, elles sont plus ou moins générales (Traité théologico-politique, chap.7).
Or
chaque corps existant se caractérise par un certain rapport de mouvement et de repos. Quand les rapports correspondant à deux corps se composent, les deux corps forment un ensemble de puissance supérieure, un tout présent dans ses parties (ainsi le chyle et la lymphe comme parties du sang, cf. lettre XXXII à Oldenburg). Bref, la notion commune est la représentation d’une composition entre deux ou plusieurs corps, et d’une unité de cette composition.
Son sens est biologique plus que mathématique; elle exprime les rapports de convenance ou de composition des corps existants. C’est seulement en second lieu qu’elles sont communes aux esprits; et là encore plus ou moins communes, puisqu’elles ne sont communes qu’aux esprits dont les corps sont concernés par la composition et l’unité de composition considérées.
Par ailleurs,
tous les corps, même ceux qui ne conviennent pas entre eux (par exemple, un poison et le corps empoisonné), ont quelque chose de commun : étendue, mouvement et repos. C’est que tous se composent du point de vue du mode infini médiat. Mais ce n’est jamais par ce qu’ils ont de commun qu’ils disconviennent (IV, 30). Reste qu’en considérant les notions communes les plus générales, on voit du dedans où cesse une convenance, où commence une disconvenance, à quel niveau se forment les « différences et oppositions » (II, 29, sc.).
Les notions communes sont nécessairement des idées adéquates : en effet, représentant une unité de composition, elles sont dans la partie comme dans le tout et ne peuvent être conçues qu’adéquatement (II, 38 et 39). Mais tout le problème est de savoir comment nous arrivons à les former. De ce point de vue, prend toute son importance la plus ou moins grande généralité de la notion commune. Car, en plusieurs endroits, Spinoza fait comme si nous allions des plus générales aux moins générales (Traité théologico-politique, chap. 7; Ethique, II, 38 et 39). Mais il s’agit alors d’un ordre d’application, où nous partons des plus générales pour comprendre du dedans l’apparition des disconvenances à des niveaux moins généraux. Les notions communes sont donc ici supposées données. Tout autre est leur ordre de formation.
Car, lorsque nous rencontrons un corps qui convient avec le nôtre, nous éprouvons un affect ou sentiment de joie-passion, bien que nous ne connaissions pas encore adéquatement ce qu’il a de commun avec nous. Jamais la tristesse, qui naît de notre rencontre avec un corps ne convenant pas avec le nôtre, ne nous induirait à former une notion commune; mais la joie-passion, comme augmentation de la puissance d’agir et de comprendre, nous induit à le faire : elle est cause occasionnelle de la notion commune.
C’est pourquoi la Raison se définit de deux façons, qui montrent que l’homme ne naît pas raisonnable, mais montrent comment il le devient par :
1° un effort pour sélectionner et organiser les bonnes rencontres, c’est-à-dire les rencontres des modes qui se composent avec nous et nous inspirent des passions joyeuses (sentiments qui conviennent avec la raison);
2° la perception et la compréhension des notions communes, c’est-à-dire des rapports qui entrent dans cette composition, d’où l’on pourra déduire d’autres rapports (raisonnement) et à partir desquels on éprouve de nouveaux sentiments, cette fois actifs (sentiments qui naissent de la raison).
C’est au début du livre V que Spinoza expose l’ordre de formation ou la genèse des notions communes, par opposition au livre II qui s’en tenait à l’ordre d’application logique:
1° « Aussi longtemps que nous ne sommes pas dominés par des affects contraires à notre nature...», affects de tristesse, aussi longtemps nous avons le pouvoir de former des notions communes (cf. V, 10, qui invoque explicitement les notions communes ainsi que les propositions précédentes). Les premières notions communes sont donc les moins générales, celles qui représentent quelque chose de commun entre mon corps et un autre qui m’affecte de joie-passion;
2° De ces notions communes découlent à leur tour des affects de joie, qui ne sont plus des passions mais des joies actives venant, pour une part, doubler les premières passions, pour une autre part, s’y substituer;
3° Ces premières notions communes et les affects actifs qui en dépendent nous donnent la force de former des notions communes plus générales, exprimant ce qu’il y a de commun, même entre notre corps et des corps qui ne lui conviennent pas, qui lui sont contraires ou l’affectent de tristesse;
4° Et de ces nouvelles notions communes découlent de nouveaux affects de joie active qui viennent doubler les tristesses et remplacer les passions nées de la tristesse.
L’importance de la théorie des notions communes doit être évaluée de plusieurs points de vue :
1° Cette théorie n’apparaît pas avant l’Ethique; elle transforme toute la conception spinoziste de la Raison, et fixe le statut du second genre de connaissance;
2° Elle répond à la question fondamentale : comment arrivons-nous à former des idées adéquates, et dans quel ordre, alors que les conditions naturelles de notre perception nous condamnent à n’avoir que des idées inadéquates?
3° Elle entraîne le remaniement le plus profond du spinozisme: alors que le Traité de la réforme ne s’élevait à l’adéquat qu’à partir d’idées géométriques encore imprégnées de fiction, les notions communes forment une mathématique du réel ou du concret grâce à laquelle la méthode géométrique est affranchie des fictions et abstractions qui en limitaient l’exercice;
4° C’est que les notions communes sont des généralités, en ce sens qu’elles ne concernent que les modes existants sans rien constituer de leur essence singulière (II, 37). Mais elles ne sont nullement fictives ou abstraites : elles représentent la composition des rapports réels entre modes ou individus existants. Alors que la géométrie ne saisit que des rapports in abstracto, les notions communes nous les font saisir tels qu’ils sont, c’est-à-dire tels qu’ils sont nécessairement incarnés dans les êtres vivants, avec les termes variables et concrets entre lesquels ils s’établissent. C’est en ce sens que les notions communes sont plus biologiques que mathématiques, et forment une géométrie naturelle qui nous fait comprendre l’unité de composition de la Nature entière et les modes de variation de cette unité.
Le statut central des notions communes est bien indiqué par l’expression « second genre de connaissance », entre le premier et le troisième. Mais de deux manières très différentes, non symétriques. Le rapport du deuxième au troisième genre apparaît sous la forme suivante : étant des idées adéquates, c’est-à-dire des idées qui sont en nous comme elles sont en Dieu (II, 38 et 39), les notions communes nous donnent nécessairement l’idée de Dieu (II, 45, 46 et 47). L’idée de Dieu vaut même pour la notion commune la plus générale, puisqu’elle exprime ce qu’il y a de plus commun entre tous les modes existants, à savoir qu’ils sont en Dieu et sont produits par Dieu (II, 45, sc. et surtout V, 36, sc., qui reconnaît que toute l’Ethique est écrite du point de vue des notions communes, jusqu’aux propositions du livre V concernant le troisième genre). L’idée de Dieu comme faisant fonction de notion commune est même l’objet d’un sentiment et d’une religion propres au second genre (V, 14-20). Reste que l’idée de Dieu n’est pas en elle-même une notion commune, et que Spinoza la distingue explicitement des notions communes (II, 47 sc.) : c’est précisément parce qu’elle comprend l’essence de Dieu, et ne fait fonction de notion commune que par rapport à la composition des modes existants. Quand donc les notions communes nous conduisent nécessairement à l’idée de Dieu, elles nous amènent à un point où tout bascule, et où le troisième genre va nous découvrir la corrélation de l’essence de Dieu et des essences singulières des êtres réels, avec un nouveau sens de l’idée de Dieu et de nouveaux sentiments constitutifs de ce troisième genre ( V, 21-37). II n’y a donc pas rupture du deuxième au troisième genre, mais passage d’un versant à l’autre de l’idée de Dieu : (V, 28) : nous passons au-delà de la Raison comme faculté des notions communes ou système des vérités éternelles concernant l’existence, nous entrons dans l’entendement intuitif comme système des vérités d’essence (parfois nommé conscience, puisque c’est là seulement que les idées se redoublent ou se réfléchissent en nous celles qu’elles sont en Dieu, et nous font expérimenter que nous sommes éternels).
Quant au rapport du second genre avec le premier, il se présente ainsi, malgré la rupture : en tant qu’elles s’appliquent exclusivement aux corps existants, les notions communes concernent des choses qui peuvent être imaginées (c’est même pourquoi l’idée de Dieu n’est pas en elle-même une notion commune, II, 47, sc.). Elles représentent en effet des compositions de rapports. Or, ces rapports caractérisent les corps en tant qu’ils conviennent les uns avec les autres, en tant qu’ils forment des ensembles et s’affectent les uns les autres, chacun laissant dans l’autre des « images », les idées correspondantes étant des imaginations. Et sans doute les notions communes ne sont-elles nullement des images ou des imaginations, puisqu’elles s’élèvent à une compréhension interne des raisons de convenance (II, 29, sc.). Mais elles ont avec l’imagination une double relation. D’une part, une relation extrinsèque : car l’imagination ou l’idée d’affection du corps n’est pas une idée adéquate, mais, quand elle exprime l’effet sur nous d’un corps qui convient avec le nôtre, elle rend possible la formation de la notion commune qui comprend du dedans et adéquatement la convenance. D’autre part, une relation intrinsèque : car l’imagination saisit comme effets extérieurs des corps les uns sur les autres ce que la notion commune explique par les rapports internes constitutifs; il y a donc une harmonie nécessairement fondée entre les caractères de l’imagination et ceux de la notion commune, qui fait que celle-ci s’appuie sur les propriétés de celle-là V, 5-9).
Chapitre V
Comment Spinoza définit-il un corps ? Un corps quelconque, Spinoza le définit de deux façons simultanées. D'une part, un corps, si petit qu'il soit, comporte toujours une infinité de particules : ce sont les rapports de repos et de mouvement, de vitesses et de lenteurs entre particules qui définissent un corps, l'individualité d'un corps. D'autre part, un corps affecte d'autres corps, ou est affecté par d'autres corps : c'est ce pouvoir d'affecter et d'être affecté qui définit aussi un corps dans son individualité. En apparence, ce sont deux propositions très simples : l'une est cinétique, l'autre est dynamique...
Le pli
Chez Leibniz [la physique s'articule sur la notion de courbure mais] la courbure d'univers se prolonge selon trois autres notions fondamentales, la fluidité de la matière, l'élasticité des corps, le ressort comme mécanisme. En premier lieu, il est certain que la matière n'irait pas d'elle-même en ligne courbe : elle suivrait la tangente. Mais l'univers est comme comprimé par une force active qui donne à la matière un mouvement curviligne, suivant une courbe sans tangente à la limite. Et la division infinie de la matière fait que la force compressive rapporte toute portion de matière aux ambiants, aux parties environnantes qui baignent et pénètrent le corps considéré, et en déterminent la courbe. Se divisant sans cesse, les parties de la matière forment de petits tourbillons dans un tourbillon, et dans ceux-ci d'autres encore plus petits et d'autres encore dans les intervalles concaves des tourbillons qui se touchent. La matière présente donc une texture infiniment poreuse, spongieuse ou caverneuse sans vide, toujours une caverne dans la caverne... On n'en concluera pourtant que la matière même la plus subtile soit parfaitement fluide et perde ainsi sa texture. [...]
Suivant Leibniz deux parties de matière réellement distinctes peuvent être inséparables...
Il faut donc dire qu'un corps a un degré de dureté aussi bien qu'un degré de fluidité, ou qu'il est essentiellement élastique, la force élastique des corps étant l'expression de la force compressive active qui s'exerce sur la matière...
... un corps flexible ou élastique a encore des parties cohérentes qui forment un pli, si bien qu'elles ne se séparent pas en parties de parties, mais plutôt se divisent à l'infini en plis de plus en plus petits qui gardent toujours une certaine cohésion. Aussi le labyrinthe du continu n'est pas une ligne qui se dissoudrait en points indépendants, comme le sable fluide en grains, mais comme une étoffe ou une feuille de papier qui se divise en plis à l'infini ou se décompose en mouvements courbes, chacun déterminé par l'entourage consistant ou conspirant. « La division du continu ne doit pas être considérée comme celle du sable en grains, mais comme celle d'une feuille de papier ou d'une tunique en plis, de telle façon qu'il puisse y avoir une infinité de plis, les uns plus petits que les autres, sans que le corps se dissolve jamais en points ou minima ». Toujours un pli dans le pli, comme une caverne dans la caverne. L'unité de matière, le plus petit élément de labyrinthe, est le pli, non pas le point qui n'est jamais une partie, mais une simple extrémité de la ligne. C'est pourquoi les parties de la matière sont des masses ou des aggrégats, comme corrélat de la force élastique compresive. Le dépli n'est donc pas le contraire du pli, mais suit le pli jusqu'à un autre pli. « Particules tournées en plis » et qu'un « effort contraire change et rechange ».[...]
En troisième lieu... le mécanisme de la matière est le ressort. Si le monde est infiniment caverneux, s'il y a des mondes dans les moindres corps, c'est parce qu'il y a « partout du ressort dans la matière », qui ne témoigne pas seulement de la division infinie des parties, mais de la progressivité dans l'acquisition et la perte du mouvement, tout en réalisant la conservation de la force. La matière-pli est une matière-temps, dont les phénomènes sont comme la décharge continuelle d'une « infinité d'arquebuses à vent ». Et là encore on devine l'affinité de la matière avec la vie, dans la mesure où c'est presque une conception musculaire de la matière qui met du ressort partout... Bref, pour autant que plier ne s'oppose pas à déplier, c'est tendre-détendre, contracter-dilater, comprimer-exploser (non pas condenser-raréfier qui impliquerait le vide).
...Un organisme se définit par des plis endogènes, tandis que la matière inorganique a des plis exogènes toujours détéerminés du dehors ou par l'entourage. Ainsi, dans le cas du vivant, il y a un pli formatif intérieur qui se transforme avec l'évolution, avec le développement de l'organisme : d'où la nécessité d'une préformation...
Ce qui rend compte du pli organique, ce sont des forces matérielles [que Leibniz nomme forces plastiques] qui doivent seulement se distinguer [des forces compresives ou élastiques], s'y ajouter, et qui suffisent, là où elles s'exercent, à faire de l'unique matière une matière organique. Elles organisent les masses... L'organisme vivant, en vertu de la préformation, a une détermination interne qui le fait passer de pli en pli ou constitue à l'infini des machines de machines...
Plier-déplier ne signifie plus simplement tendre-détendre, contracter-dilater, mais envelopper-développer, involuer-évoluer. L'organisme se définit par sa capacité de plier ses propres parties à l'infini, et de les déplier, jusqu'au degré de développement assigné à l'espèce...
Déplier, c'est augmenter, croître, et plier c'est diminuer, réduire, « rentrer dans l'enfoncement d'un monde »...
La matière se plie deux fois, une fois sous les forces élastiques, une fois sous les forces plastiques sans qu'on puisse passer des premières aux secondes.
La perception dans les plis
Je dois avoir un corps, c'est une nécessité morale, une « exigence ». En premier lieu, je dois avoir un corps parce qu'il y a de l'obscur en moi... Avec ce premier argument Leibniz ne dit pas que seul le corps explique ce qu'il y a d'obscur dans l'esprit. Au contraire, l'esprit est obscur, le fond de l'esprit est sombre, et c'est cette nature sombre qui explique et exige un corps. Appelons « matière première » notre puissance passive ou la limitation de notre activité : nous disons que notre matière première est exigence d'étendue, mais aussi de résistance ou d'antitypie, et encore exigence individuée d'avoir un corps qui nous appartient. C'est parce qu'il y a une infinité de monades individuelles que chacune doit avoir un corps individué, ce corps étant comme l'ombre des autres monades sur elle. Il n'y a pas de l'obscur en nous parce que nous avons un corps, mais nous devons avoir un corps parce que notre esprit a une zone d'expression privilégiée, claire et distincte. C'est maintenant la zone claire qui est exigence d'avoir un corps.
[...]
C'est parce que chaque monade a une zone claire qu'elle doit avoir un corps, cette zone constituant un rapport avec le corps, non pas un rapport donné, mais un rapport génétique, engendrant son propre « relatum ». C'est parce que nous avons une zone claire que nous devons avoir un corps chargé de la parcourir ou de l'explorer, de la naissance à la mort.
[...]
Comme le monde n'existe pas hors des monades qui l'expriment, il est inclus dans chacune sous forme de perceptions ou de « représentants », éléments actuels infiniment petits... petites perceptions sans objet, des microperceptions hallucinatoires... un clapotement, une rumeur, un brouillard, une danse de poussières. C'est un état de mort ou de catalepsie, de sommeil ou d'endormissement, d'évanouissement, d'étourdissement. C'est comme si le fond de chaque monade était constitué d'une infinité de petits plis qui ne cessent de se faire et de se défaire en toutes directions, si bien que la spontanéité de la monade est comme celle du dormeur qui se tourne et se retourne sur sa couche... Les microperceptions ou représentants sont ces petits plis dans tous les sens, plis dans plis, sur plis, selon plis... Et ce sont ces petites perceptions obscures, confuses, qui composent nos macroperceptions, nos aperceptions conscientes, claires et distinctes : jamais une perception consciente n'arriverait si elle n'intégrait un ensemble infini de petites perceptions qui déséquilibrent la macroperception précédente et préparent la suivante...
Les petites perceptions sont le passage d'une perception à une autre, autant que les composantes de chaque perception. Elles constituent l'état animal par excellence : l'inquiétude. Ce sont des « aiguillons », petites pliures qui ne sont pas moins présentes dans le plaisir que dans la douleur. Les aiguillons sont les représentants du monde dans la monade close. L'animal aux aguets, l'âme aux aguets, signifie qu'il y a toujours des petites perceptions qui ne s'intègrent pas dans la perception présente, mais aussi des petites perceptions qui ne s'intégraient pas dans la précédente et nourrisent celle qui arrive « c'était donc çà ». [Or] le macroscopique distingue les perceptions, et les appétitions qui sont le passage d'une perception à une autre. C'est la condition des grands plis, des drapés. Mais le niveau microscopique ne distingue plus les petites perceptions et les petites inclinations : aiguillons de l'inquiétude qui font l'instabilité de toute perception.
[...]
La question est de savoir comment l'on passe des petites perceptions aux perceptions conscientes....[Même si Leibniz] s'exprime parfois en terme de totalité, il s'agit d'autre chose que de l'addition de parties homogènes, il ne manque jamais de préciser que le rapport de la petite perception à la perception consciente n'est pas de partie à tout, mais d'ordinaire à remarquable ou notable : « Ce qui est remarquable doit être composé de parties qui ne le sont pas ». Nous devons comprendre littéralement, cad mathématiquement, qu'une perception consciente se produit lorsque deux parties hétérogènes au moins entrent dans un rapport différentiel qui détermine une singularité.
[...]
Toute conscience est seuil... Si l'on se donne des seuils comme autant de minima de conscience, les petites perceptions sont chaque fois plus petites que le minimum possible : infiniment petites en ce sens. Sont sélectionnées dans chaque ordre celles qui entrent dans des rapports différentiels et produisent ainsi la qualité qui surgit au seuil de conscience considéré. Les petites perceptions ne sont donc pas des parties de la perception consciente mais des requisits ou éléments génétiques des « différentielles de la conscience ».
L'épuisé
L'espace jouit de potentialités pour autant qu'il rend possible la réalisation d'événements. Il précède donc la réalisation, et la potentialité appartient elle-même au possible. Mais n'était-ce pas également le cas de l'image qui proposait déjà une manière spécifique d'épuiser le possible. On dirait cette fois qu'une image telle qu'elle se tient dans le vide hors espace, mais aussi à l'écart des mots, des histoires et des souvenirs, emmagasine une fantastique énergie potentielle qu'elle fait détonner en se dissipant. Ce qui compte dans l'image, ce n'est pas le pauvre contenu, mais la folle énergie captée, prête à éclater qui fait que les images ne durent jamais longtemps. Elles se confondent avec la détonation, la combustion, la dissipation de leur énergie condensée. Comme d'ultimes particules, elles ne durent jamais longtemps, et le Bing déclenche une « image presque jamais une seconde ».
|
Propos 1983
Lire ou comprendre, c’est toujours véritablement une extraction, et pire, c’est une absorption, du cannibalisme. Vous en faites quelque chose qui devient vôtre.


|
|
facebook
daoyinreims@gmail.com
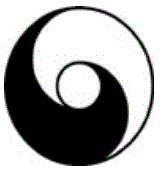
03 26 83 87 27
|
Bons sentiments
Bref commentaire
|
|