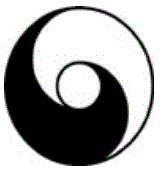Ainsi parlait Zarathoustra
De la vertu qui se donne
Lorsque Zarathoustra eut pris congé de la ville que son cœur aimait, et dont le nom est « la Vache multicolore », beaucoup de ceux qui s’appelaient ses disciples l’accompagnèrent et lui firent la reconduite. C’est ainsi qu’ils arrivèrent à un carrefour : alors Zarathoustra leur dit qu’il voulait continuer seul la route, car il était ami des marches solitaires. Ses disciples, cependant, en lui disant adieu, lui firent hommage d’un bâton dont la poignée d’or était un serpent s’enroulant autour du soleil. Zarathoustra se réjouit du bâton et s’appuya dessus ; puis il dit à ses disciples :
Dites-moi donc, pourquoi l’or est-il devenu la plus haute valeur ? C’est parce qu’il est rare et inutile, étincelant et doux dans son éclat ; il se donne toujours.
Ce n’est que comme symbole de la plus haute vertu que l’or atteignit la plus haute valeur. Luisant comme de l’or est le regard de celui qui donne. L’éclat de l’or conclut la paix entre la lune et le soleil.
La plus haute vertu est rare et inutile, elle est étincelante et d’un doux éclat : une vertu qui donne est la plus haute vertu.
En vérité, je vous devine, mes disciples : vous aspirez comme moi à la vertu qui donne. Qu’auriez-vous de commun avec les chats et les loups ?
Vous avez soif de devenir vous-mêmes des offrandes et des présents : c’est pourquoi vous avez soif d’amasser toutes les richesses dans vos âmes.
Votre âme est insatiable à désirer des trésors et des joyaux, puisque votre vertu est insatiable dans sa volonté de donner.
Vous contraignez toutes choses à s’approcher et à entrer en vous, afin qu’elles recoulent de votre source, comme les dons de votre amour.
En vérité, il faut qu’un tel amour qui donne se fasse le brigand de toutes les valeurs ; mais j’appelle sain et sacré cet égoïsme.
Il y a un autre égoïsme, trop pauvre celui-là, et toujours affamé, un égoïsme qui veut toujours voler, c’est l’égoïsme des malades, l’égoïsme malade.
Avec les yeux du voleur, il garde tout ce qui brille, avec l’avidité de la faim, il mesure celui qui a largement de quoi manger, et toujours il rampe autour de la table de celui qui donne.
Une telle envie est la voix de la maladie, la voix d’une invisible dégénérescence ; dans cet égoïsme l’envie de voler témoigne d’un corps malade.
Dites-moi, mes frères, quelle chose nous semble mauvaise pour nous et la plus mauvaise de toutes ? N’est-ce pas la dégénérescence ? — Et nous concluons toujours à la dégénérescence quand l’âme qui donne est absente.
Notre chemin va vers les hauteurs, de l’espèce à l’espèce supérieure. Mais nous frémissons lorsque parle le sens dégénéré, le sens qui dit : « Tout pour moi. »
Notre sens vole vers les hauteurs : c’est ainsi qu’il est un symbole de notre corps, le symbole d’une élévation. Les symboles de ces élévations portent les noms des vertus.
Ainsi le corps traverse l’histoire, il devient et lutte. Et l’esprit — qu’est-il pour le corps ? Il est le héraut des luttes et des victoires du corps, son compagnon et son écho.
Tous les noms du bien et du mal sont des symboles : ils n’exprimaient point, ils font signe. Est fou qui veut leur demander la connaissance !
Mes frères, prenez garde aux heures où votre esprit veut parler en symboles : c’est là qu’est l’origine de votre vertu.
C’est là que votre corps est élevé et ressuscité ; il ravit l’esprit de sa félicité, afin qu’il devienne créateur, qu’il évalue et qu’il aime, qu’il soit le bienfaiteur de toutes choses.
Quand votre cœur bouillonne, large et plein, pareil au grand fleuve, bénédiction et danger pour les riverains : c’est alors l’origine de votre vertu.
Quand vous vous élevez au-dessus de la louange et du blâme, et quand votre volonté, la volonté d’un homme qui aime, veut commander à toutes choses : c’est alors l’origine de votre vertu.
Quand vous méprisez ce qui est agréable, la couche molle, et quand vous ne pouvez pas vous reposer assez loin de la mollesse : c’est alors l’origine de votre vertu.
Quand vous n’avez plus qu’une seule volonté et quand ce changement de toute peine s’appelle nécessité pour vous : c’est alors l’origine de votre vertu.
En vérité, c’est là un nouveau « bien et mal » ! En vérité, c’est un nouveau murmure profond et la voix d’une source nouvelle !
Elle donne la puissance, cette nouvelle vertu ; elle est une pensée régnante et, autour de cette pensée, une âme avisée : un soleil doré et autour de lui le serpent de la connaissance.
Ici Zarathoustra se tut quelque temps et regarda ses disciples avec amour. Puis il continua à parler ainsi, et sa voix s’était transformée :
Restez fidèles à la terre, mes frères, avec la puissance de votre vertu! Que votre amour prodigue et votre connaissance servent le sens de la terre. Je vous en prie et vous en conjure.
Ne laissez pas votre vertu s’envoler des choses terrestres et battre des ailes contre des murs éternels ! Hélas ! il y eut toujours tant de vertu égarée !
Ramenez, comme moi, la vertu égarée sur la terre — oui, ramenez-la vers le corps et vers la vie ; afin qu’elle donne un sens à la terre, un sens humain !
L’esprit tout comme la vertu se sont égarés et mépris de mille façons différentes. Hélas ! dans notre corps habite maintenant encore cette folie et cette méprise : elles sont devenues corps et volonté !
L’esprit et la vertu se sont essayés et égarés de mille façons différentes. Oui, l’homme n'était qu'un essai. Hélas ! combien d’ignorances et d’erreurs se sont incorporées en nous !
Ce n’est pas seulement la raison millénaire, c’est aussi leur folie qui éclate en nous. Il est dangereux d’être héritier.
Nous luttons encore pas à pas avec le géant nommé hasard et, sur toute l’humanité, jusqu’à présent ce qui est insensé, ce qui a perdu le sens.
Que votre esprit et votre vertu servent le sens de la terre, mes frères : et la valeur de toutes choses se renouvellera par vous ! C’est pourquoi vous devez être des créateurs.
Le corps se purifie par le savoir ; il s’élève en essayant avec science ; pour celui qui cherche la connaissance tous les instincts se sanctifient ; l’âme de celui qui est élevé se réjouit.
Médecin, aide-toi toi-même et tu sauras secourir ton malade. Que ce soit son meilleur secours de voir, de ses propres yeux, celui qui se guérit lui-même.
Il y a mille sentiers qui n’ont jamais été parcourus, mille santés et mille terres cachées de la vie. L’homme et la terre de l'hommes n’ont pas encore été découverts et épuisés.
Veillez et écoutez, vous les solitaires. Des souffles aux essors secrets viennent de l’avenir ; un joyeux messager cherche de fines oreilles.
Solitaires d’aujourd’hui, vous qui vivez séparés, vous serez un jour un peuple. Vous qui vous êtes vous-mêmes élus, vous formerez un jour un peuple élu et c’est de ce peuple que naîtra le Surhumain.
En vérité, la terre deviendra un jour un lieu de guérison ! Et déjà une odeur nouvelle l’entoure, une odeur salutaire, -et un espoir nouveau !
Généalogie de la morale
Nous ne nous connaissons pas, nous qui cherchons la connaissance ; nous nous ignorons nous-mêmes : et il y a une bonne raison pour cela. Nous ne nous sommes jamais cherchés — comment donc se pourrait-il que nous nous découvrions un jour ? On a dit justement : « Là où est votre trésor, là aussi est votre cœur » ; et notre trésor est là où bourdonnent les ruches de notre connaissance. C’est vers ces ruches que nous sommes sans cesse en chemin, en vrais insectes ailés qui butinent le miel de l’esprit, et, en somme, nous n’avons à cœur qu’une seule chose — « rapporter » quelque butin. En dehors de cela, pour ce qui concerne la vie et ce qu’on appelle ces « événements » — qui de nous sérieusement s’en préoccupe ? Qui a le temps de s’en préoccuper ? Pour de telles affaires jamais, je le crains, nous ne sommes vraiment « à notre affaire » ; nous n’y avons pas notre cœur, — ni même notre oreille ! Mais plutôt, de même qu’un homme divinement distrait, absorbé en lui-même, aux oreilles de qui l’horloge vient de sonner, avec rage, ses douze coups de midi, s’éveille en sursaut et s’écrie : « Quelle heure vient-il donc de sonner ? » de même, nous aussi, nous nous frottons parfois les oreilles après coup et nous nous demandons, tout étonnés, tout confus : « Que nous est-il donc arrivé ? » Mieux encore : « Qui donc sommes-nous en dernière analyse ? » Et nous les recomptons ensuite, les douze coups d’horloge, encore frémissants de notre passé, de notre vie, de notre être — hélas ! et nous nous trompons dans notre compte… C’est que fatalement nous nous demeurons étrangers à nous-mêmes, nous ne nous comprenons pas, il faut que nous nous confondions avec d’autres, nous sommes éternellement condamnés à subir cette loi : « Chacun est le plus étranger à soi-même », — à l’égard de nous-mêmes nous ne sommes point de ceux qui « cherchent la connaissance »…
Je considère la mauvaise conscience comme la profonde maladie dans laquelle l’homme devait sombrer sous la pression du plus radical de tous les changements qu’il ait vécu de manière générale – le changement qui survint lorsqu’il se trouva définitivement prisonnier de l’envoûtement de la société et de la paix. Ce qui se produisit de toute nécessité pour les animaux aquatiques lorsqu’ils furent contraints, soit de devenir animaux terrestres, soit de périr, ce n’est pas autre chose qui arriva à ces demi-animaux adaptés avec bonheur à l’étendue sauvage, à la guerre, au vagabondage, à l’aventure, - d’un seul coup, tous leurs instincts se trouvèrent dévalorisés et «suspendus». Il leur fallait désormais marcher sur leurs pieds et «se porter eux-mêmes» là où auparavant ils étaient portés par l’eau : une pesanteur effroyable les écrasait. Ils se sentaient gauches pour les besognes les plus simples, pour ce monde nouveau et inconnu, ils n’avaient plus leurs anciens guides, les pulsions régulatrices, guidant inconsciemment avec sûreté, - ils en étaient réduits à penser, conclure, calculer, combiner des causes et des effets, ces malheureux, à leur «conscience», à leur organe le plus pauvre et le plus exposé à la méprise ! Je crois que jamais il n’a existé sur terre un tel sentiment de détresse, un tel malaise de plomb, - et ces instincts anciens n’avaient pas pour autant cessé d’un seul coup de poser leurs exigences. Seulement, il était difficile et rarement possible de faire leurs volontés : ils devaient pour l’essentiel rechercher des satisfactions nouvelles et comme souterraines. Tous les instincts qui ne se déchargent pas vers l’extérieur se tournent vers l’intérieur – c’est cela que j’appelle l’intériorisation de l’homme : c’est seulement ainsi que pousse en l’homme ce que l’on appellera par la suite son «âme». Tout le monde intérieur, originellement mince, comme enserré entre deux peaux, a grossi et s'est éclos, a gagné en profondeur, en largeur, en hauteur, à mesure que la décharge de l’homme vers l’extérieur a été inhibée. Les terribles remparts grâce auxquels l’organisation de l’Etat se protégeait contre les anciens instincts de liberté – les châtiments font partie au premier chef de ces remparts produisirent ceci que tous ces instincts de l’homme sauvage, libre, vagabondant se retournèrent, se tournèrent contre l’homme lui-même. L’hostilité, la cruauté, le plaisir pris à la persécution, à l’agression, au changement, à la destruction – tout cela se tournant contre le détenteur de tels instincts : voilà l’origine de la «mauvaise conscience».
[...]De temps en temps accordez-moi – si du moins il existe, par-delà le bien et le mal, des protectrices célestes ! – accordez-moi de jeter un regard sur quelque chose de parfait, de réussi jusqu’au bout, d’heureux, de puissant, de triomphant, de la part de quoi il y ait encore quelque chose à craindre ! Un regard sur un homme qui justifie l’homme, sur une heureuse réussite qui apporte à l’homme son complément et son salut, grâce à laquelle on puisse garder sa foi en l’homme !...
(Car) les choses sont ainsi : c’est dans le rapetissement et l’égalisation de l’homme européen que réside notre pire danger, car ce spectacle fatigue...
Aujourd’hui, nous ne voyons rien qui veuille devenir plus grand, nous pressentons que l’on ne cesse de décliner, de décliner pour devenir plus inconsistant, plus gentil, plus prudent, plus à son aise, plus médiocre, plus indifférent, plus chinois, plus chrétien — l’homme, cela ne fait aucun doute, ne cesse de devenir “meilleur”...
C’est justement en cela que réside la fatalité de l’Europe — avec la peur de l’homme, nous avons également subi la perte de l’amour pour lui, du respect pour lui, de l’espoir que l’on plaçait en lui, même de la volonté dont il était l’objet. Désormais, le spectacle de l’homme fatigue — qu’est-ce que le nihilisme aujourd’hui, sinon cela ?... Nous sommes fatigués de l’homme...
La philosophie à l'âge de la tragédie grecque
L’opinion commune croit certes reconnaître quelque chose de fixe, d’achevé, de constant, alors qu’en réalité lumière et obscurité, amertume et douceur sont à chaque instant associées et reliées l’une à l’autre comme deux lutteurs dont tantôt l’un, tantôt l’autre prend l’avantage. Pour Héraclite, le miel est à la fois amer et doux, et le monde est lui-même une coupe à mélange qui doit être constamment agitée. Tout devenir naît de la lutte des contraires. Les qualités définies qui nous semblent durables n’expriment que la suprématie momentanée de l’un des combattants, mais la lutte n’en continue pas moins, le combat se poursuit éternellement. C’est en fonction de ce combat que tout ce qui se produit advient et c’est précisément ce combat qui révèle la justice cohérente et sévère, liée à des lois éternelles. Seul un Grec était en mesure d’inventer une telle conception pour en faire le fondement d’une cosmodicée.
Le Gai savoir
Livre II
De l’origine de la poésie. — Les amateurs du fantastique chez l’homme, qui représentent en même temps la doctrine de la moralité instinctive, raisonnent ainsi : « En admettant que l’on ait vénéré de tout temps ce qui est utile comme divinité supérieure, d’où a bien alors pu venir la poésie ? — cette façon de rythmer le discours qui, loin de favoriser l’intelligibilité de la communication, en diminue plutôt la clarté et qui, malgré cela, comme une dérision à toute convenance utile, a levé et lève encore sa graine partout sur la terre ! La sauvage et belle déraison vous réfute, oh ! utilitaires ! C’est précisément la volonté d’être une fois délivré de l’utilité qui a élevé l’homme, qui lui a inspiré la moralité et l’art ! » — Eh bien ! dans ce cas particulier il me faut parler en faveur des utilitaires, — ils ont si rarement raison que c’est à faire pitié ! C’est pourtant l’utilité, et une très grande utilité que l’on avait en vue, dans ces temps anciens qui donnèrent naissance à la poésie — alors qu’on laissa pénétrer dans le discours le rythme, cette force qui ordonne à nouveau tous les atomes de la phrase, qui enjoint de choisir les mots et qui colore à nouveau la pensée, la rendant plus obscure, plus étrange, plus lointaine : c’est là, il est vrai, une utilité superstitieuse. On voulut graver les désirs humains dans l’esprit des dieux au moyen du rythme, après que l’on eut remarqué qu’un homme retient mieux dans sa mémoire un vers qu’une phrase en prose ; par le tic tac rythmique on pensait aussi se faire entendre à de plus grandes distances ; la prière rythmique semblait s’approcher davantage de l’oreille des dieux. Mais avant tout on voulait tirer parti de cette subjugation élémentaire qui saisit l’homme à l’audition de la musique ; le rythme est une contrainte ; il engendre un irrésistible désir de céder, de se mettre à l’unisson ; non seulement les pas que l’on fait avec les pieds, mais encore ceux de l’âme suivant la mesure, — et il en sera probablement de même, ainsi raisonnait-on, de l’âme des dieux ! On essaya donc de les forcer par le rythme et d’exercer une contrainte sur eux : on leur lança la poésie comme un lacet magique. Il existait encore une représentation plus singulière, et celle-ci a peut-être contribué le plus puissamment à la formation de la poésie. Chez les pythagoriciens la poésie apparaît comme enseignement philosophique et comme procédé d’éducation : mais bien avant qu’il y eût des philosophes on accordait à la musique la force de décharger les passions, de purifier l’âme, d’adoucir la ferocia animi — et justement par ce qu’il y a de rythmique dans la musique. Lorsque la juste tension et l’harmonie de l’âme venaient à se perdre, il fallait se mettre à danser, — c’était là l’ordonnance de cette thérapeutique. Avec elle Terpandre apaisa une émeute, Empédocle adoucit un fou furieux, Damon purifia un jeune homme languissant d’amour ; avec elle on mettait aussi en traitement les dieux sauvages, assoiffés de vengeance. D’abord, en portant à leur comble le délire et l’extravagance de leurs passions, on rendait donc l’enragé frénétique, l’assoiffé ivre de vengeance : — tous les cultes orgiaques veulent décharger en une seule fois la férocité d’une divinité et en faire une orgie pour qu’après cela elle se sente plus libre et plus tranquille et laisse l’homme en repos. Melos signifie, d’après sa racine, un moyen d’apaisement, non parce que le chant est doux par lui-même, mais puisque ses effets ultérieurs produisent la douceur. — Et l’on admet que, non seulement dans le chant religieux, mais encore dans le chant profane des temps les plus reculés, le rythme exerçait une puissance magique, par exemple lorsque l’on puisait de l’eau ou lorsque l’on ramait : le chant est un enchantement des démons que l’on imaginait actifs dès que l’on en usait, il rend les démons serviables, esclaves et instruments de l’homme. Et dès que l’on agit on tient un motif à chanter, chaque action est rattachée au secours des esprits : les formules magiques et les enchantements semblent être les formes primitives de la poésie. Lorsque le vers était employé pour un oracle — les Grecs disaient que l’hexamètre avait été inventé à Delphes — le rythme devait là aussi exercer une contrainte. Se faire prophétiser cela signifie primitivement (d’après l’étymologie du mot grec qui me semble probable) : se faire déterminer quelque chose ; on croit pouvoir contraindre l’avenir en gagnant Apollon à sa cause : lui qui, d’après la représentation ancienne, est bien plus qu’un dieu prévoyant l’avenir. Telle que la formule est exprimée, à la lettre et d’après son exactitude rythmique, telle elle lie l’avenir : mais la formule est de l’invention d’Apollon qui, en tant que dieu des rythmes, peut lier aussi les divinités du destin. — Dans l’ensemble, y eut-il en somme jamais, pour l’homme ancien et superstitieux, quelque chose de plus utile que le rythme ? Par lui on pouvait tout faire : accélérer un travail d’une façon magique ; forcer un dieu à apparaître, à être présent, à écouter ; accommoder l’avenir d’après sa propre volonté ; décharger sa propre âme d’un trop-plein quelconque (la peur, la manie, la pitié, la vengeance), et non seulement sa propre âme mais encore celle du plus méchant démon, — sans le vers on n’était rien, par le vers on devenait presque un dieu. Un pareil sentiment fondamental ne peut plus être entièrement extirpé, — et, maintenant encore, après un travail de milliers d’années pour combattre une telle superstition, le plus sage d’entre nous devient à l’occasion un insensé du rythme, ne fût-ce qu’en ceci qu’il sent une idée plus vraie lorsqu’elle prend une forme métrique et s’avance avec un divin « houpsa » ! N’est-ce pas chose très plaisante que les philosophes les plus sérieux, malgré toute la sévérité qu’ils mettent d’autre part à manier les certitudes, s’appuient toujours encore sur des sentences de poètes pour donner à leurs idées de la force et de l’authenticité ? — et pourtant il est plus dangereux pour une idée d’être approuvée par les poètes que d’être contredite par eux ! Car, comme dit Homère : « Les poètes mentent beaucoup ! » —
Livre III
Gardons-nous de penser que le monde est un être vivant. Vers où s’étendrait-il ? De quoi se nourrirait-il ? Comment pourrait-il croître et augmenter ? Nous savons à peine ce qu’est l’organique : et nous réinterpréterions l’indiciblement dérivé, tardif, rare, fortuit que nous percevons aujourd’hui sur la croûte de la terre comme l’essentiel, l’universel, l’éternel, ainsi que le font ceux qui qualifient le tout d’organisme ? Cela suscite en moi le dégoût. Gardons-nous déjà de croire que le tout est une machine ; il n’est certainement pas construit pour atteindre un but, nous lui faisons bien trop d’honneur en lui appliquant le terme de « machine ». Gardons-nous de présupposer absolument et partout quelque chose d’aussi bien conformé que le mouvement cyclique des étoiles les plus proches de nous ; un simple coup d’œil sur la Voie lactée suscite le doute et nous fait nous demander s’il n’existe pas là des mouvements bien plus grossiers et contradictoires, et de même des étoiles suivant d’éternelles trajectoires de chute rectilignes et d’autres choses du même ordre. L’ordre astral dans lequel nous vivons est une exception ; cet ordre, et la durée considérable dont il est la condition, a à son tour rendu possible l’exception des exceptions : la formation de l’organique. Le caractère général du monde est au contraire de toute éternité chaos, non pas au sens de l’absence de nécessité, mais au contraire au sens de l’absence d’ordre, d’articulation, de forme, de beauté, de sagesse et de tous nos anthropomorphismes esthétiques quelque nom qu’on leur donne.
Livre IV
Zum neuen Jahr - Noch lebe ich, noch denke ich. Ich muss noch leben, denn ich muss noch denken. Sum ergo cogito, cogito ergo sum...
Je vis encore, je pense encore : il faut encore que je vive, car il faut encore que je pense. Sum, ergo cogito : cogito, ergo sum. Aujourd’hui chacun ose exprimer son voeu et sa pensée la plus chère : et, moi aussi, je vais dire ce qu’aujourd’hui je souhaite de moi-même et quelle est la pensée que, cette année, j’ai prise à cœur la première — quelle est la pensée qui devra être dorénavant pour moi la raison, la garantie et la douceur de vivre ! Je veux apprendre toujours davantage à considérer comme la beauté ce qu’il y a de nécessaire dans les choses : c’est ainsi que je serai de ceux qui rendent belles les choses. Amor fati : que cela soit dorénavant mon amour. Je ne veux pas mener une guerre contre le laid. Je ne veux pas accuser, je ne veux même pas accuser les accusateurs. Détourner mon regard, que ce soit là ma seule négation ! Et, somme toute, pour voir grand : je veux, quelle que soit la circonstance, n’être rien d'autre que quelqu'un qui dit oui !
Qu’est-ce que c’est que connaître ? — Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere ! dit Spinoza, avec cette simplicité et cette élévation qui lui sont propres. Cet intelligere qu’est-il en dernière instance, en tant que forme par quoi les trois autres choses nous deviennent sensibles d’un seul coup ? Le résultat de différents instincts qui se contredisent, du désir de se moquer, de se plaindre ou de maudire ? Avant que la connaissance soit possible, il fallut que chacun de ces instincts avançât son avis incomplet sur l’objet ou l’événement ; alors commençait la lutte de ces jugements incomplets et le résultat était parfois un moyen terme, une pacification, une approbation des trois côtés, une espèce de justice et de contrat : car au moyen de la justice et du contrat tous ces instincts peuvent se conserver dans l’existence et garder raison en même temps. Nous qui ne trouvons dans notre conscience que les traces des dernières scènes de réconciliation, les définitifs règlements de comptes de ce long procès, nous nous figurons par conséquent qu’intelligere est quelque chose de conciliant, de juste, de bien, quelque chose d’essentiellement opposé aux instincts ; tandis que ce n’est en réalité qu’un certain rapport des instincts entre eux. Longtemps on a considéré la pensée consciente comme la pensée par excellence : maintenant seulement nous commençons à entrevoir la vérité, c’est-à-dire que la plus grande partie de notre activité intellectuelle s’effectue d’une façon inconsciente et sans que nous en ayons la sensation ; mais je crois que ces instincts qui luttent entre eux s’entendront fort bien à se rendre perceptibles et à se faire mal réciproquement ; — il se peut que ce formidable et soudain épuisement dont tous les penseurs sont atteints ait ici son origine (c’est l’épuisement sur le champ de bataille). Oui, peut-être y a-t-il dans notre intérieur en lutte bien des héroïsmes cachés, mais certainement rien de divin, rien qui repose éternellement en soi-même, comme pensait Spinoza. La pensée consciente, et surtout celle des philosophes, est la moins violente et par conséquent aussi, relativement, la plus douce et la plus tranquille catégorie de la pensée : et c’est pourquoi il arrive le plus souvent au philosophe d’être trompé sur la nature de la connaissance.
Livre V
La morale en tant que problème. — Le manque d’individus s’expie partout ; une personnalité affaiblie, mince, éteinte, qui se nie et se renie elle-même, n’est plus bonne à rien, — et, moins qu’à toute autre chose, à faire de la philosophie. Le « désintéressement » n’a point de valeur au ciel et sur la terre ; les grands problèmes exigent tous le grand amour, et il n’y a que les esprits vigoureux, nets et sûrs qui en soient capables, les esprits à base solide. Autre chose est, si un penseur prend personnellement position en face de ses problèmes, de telle sorte qu’il trouve en eux sa destinée, sa peine et aussi son plus grand bonheur, ou s’il s’approche de ses problèmes d’une façon « impersonnelle » : c’est-à-dire s’il n’y touche et ne les saisit qu’avec des pensées de froide curiosité. Dans ce dernier cas il n’en résultera rien, car une chose est certaine, les grands problèmes, en admettant même qu’ils se laissent saisir, ne se laissent point garder par les êtres au sang de grenouille et par les débiles. Telle fut leur fantaisie de toute éternité, — une fantaisie qu’ils partagent d’ailleurs avec toutes les braves petites femmes. — Or, d’où vient que je n’aie encore rencontré personne, pas même dans les livres, personne qui se placerait devant la morale comme si elle était quelque chose d’individuel, qui ferait de la morale un problème et de ce problème sa peine, sa souffrance, sa volupté et sa passion individuelles ? Il est évident que jusqu’à présent la morale n’a pas été un problème ; elle a été, au contraire, le terrain neutre, où, après toutes les méfiances, les dissentiments et les contradictions, on finissait par tomber d’accord, le lieu sacré de la paix, où les penseurs se reposent d’eux-mêmes, où ils respirent et revivent. Je ne vois personne qui ait osé une critique des évaluations morales, je constate même, dans cette matière, l’absence des tentatives de la curiosité scientifique, de cette imagination délicate et hasardeuse des psychologues et des historiens qui anticipe souvent sur un problème, qui le saisit au vol sans savoir au juste ce qu’elle tient. À peine si j’ai découvert quelques rares essais de parvenir à une histoire des origines de ces sentiments et de ces appréciations (ce qui est toute autre chose qu’une critique et encore autre chose que l’histoire des systèmes éthiques) : dans un cas isolé, j’ai tout fait pour encourager un penchant et un talent portés vers ce genre d’histoire — je constate aujourd’hui que c’était en vain. Ces historiens de la morale (qui sont surtout des Anglais) sont de mince importance : ils se trouvent généralement encore, de façon ingénue, sous les ordres d’une morale définie ; ils en sont, sans s’en douter, les porte-boucliers et l’escorte. Ils suivent en cela ce préjugé populaire de l’Europe chrétienne, ce préjugé que l’on répète toujours avec tant de bonne foi et qui veut que les caractères essentiels de l’action morale soient l’altruisme, le renoncement, le sacrifice de soi-même, la pitié, la compassion. Leurs fautes habituelles, dans leurs hypothèses, c’est d’admettre une sorte de consentement entre les peuples, au moins entre les peuples domestiqués, au sujet de certains préceptes de la morale et d’en conclure à une obligation absolue, même pour les relations entre individus. Quand, au contraire, ils se sont rendu compte de cette vérité que, chez les différents peuples, les appréciations morales sont nécessairement différentes, ils veulent en conclure que toute morale est sans obligation. Les deux points de vue sont également enfantins. La faute des plus subtils d’entre eux c’est de découvrir et de critiquer les opinions, peut-être erronées, qu’un peuple pourrait avoir sur sa morale ou bien les hommes sur toute morale humaine, soit des opinions sur l’origine de la morale, la sanction religieuse, le préjugé du libre arbitre, etc., et de croire qu’ils ont, de ce fait, critiqué cette morale elle-même. Mais la valeur du précepte « Tu dois » est profondément différente et indépendante de pareilles opinions sur ce précepte, et de l’ivraie d’erreurs dont il est peut-être couvert : de même l’efficacité d’un médicament sur un malade n’a aucun rapport avec les notions médicales de ce malade, qu’elles soient scientifiques ou qu’il pense comme une vieille femme. Une morale pourrait même avoir son origine dans une erreur : cette constatation ne ferait même pas toucher au problème de sa valeur. — La valeur de ce médicament, le plus célèbre de tous, de ce médicament que l’on appelle morale, n’a donc été examinée jusqu’à présent par personne : il faudrait, pour cela, avant toute autre chose, qu’elle fût mise en question. Eh bien ! c’est précisément là notre œuvre. —
L’origine de notre notion de « connaissance ». — Je ramasse cette explication dans la rue ; j’ai entendu quelqu’un parmi le peuple dire : « Il m’a reconnu » — : et je me demande ce que le peuple entend au fond par connaître ? que veut-il lorsqu’il veut de la « connaissance » ? Rien que cela : quelque chose d’étranger doit être ramené à quelque chose de connu. Et nous autres philosophes — par « connaissance » voudrions-nous peut-être entendre davantage ! Ce qui est connu, c’est-à-dire : ce à quoi nous sommes habitués, en sorte que nous ne nous en étonnons plus, notre besogne quotidienne, une règle quelconque qui nous tient, toute chose que nous savons nous être familière : — comment ? notre besoin de connaissance n’est-il pas précisément notre besoin de quelque chose de connu ? le désir de découvrir, parmi toutes les choses étrangères, inaccoutumées, incertaines, quelque chose qui ne nous inquiétât plus ? Ne serait-ce pas l’instinct de peur qui nous pousse à connaître ? La jubilation de l'homme de connaissance ne serait-elle pas la jubilation de la sûreté reconquise ?… Tel philosophe considéra le monde comme « connu » lorsqu’il l’eut ramené à l’« idée ». Hélas ! n’en était-il pas ainsi parce que l’« idée » était pour lui chose connue, habituelle ?
Il nous est impossible de voir au-delà de l’angle de notre regard : il y a une curiosité sans espoir à vouloir connaître quelles autres espèces d’intellects et de perspectives il pourrait y avoir, par exemple, s’il y a des êtres qui peuvent concevoir le temps en arrière, ou tour à tour en avant et en arrière (par quoi on obtiendrait une autre direction de vie et une autre conception de la cause et de l’effet). J’espère, cependant, que nous sommes au moins, de nos jours, assez éloignés de ce ridicule manque de modestie de vouloir décréter de notre angle que ce n’est que de cet angle que l’on a le droit d’avoir des perspectives. Le monde, au contraire, est redevenu pour nous « infini » : en tant que nous ne pouvons pas réfuter la possibilité qu’il contienne des interprétations à l’infini. Encore une fois le grand frisson nous prend : – mais qui donc aurait envie de diviniser de nouveau, immédiatement, à l’ancienne manière, ce monstre de monde inconnu ? Adorer cet inconnu désormais comme le « dieu inconnu » ? Hélas, il y a trop de possibilités non divines d’interprétation qui font partie de cet inconnu, trop de diableries, de bêtises, de folies d’interprétation, – sans compter la nôtre, cette interprétation humaine, trop humaine que nous connaissons.
Généalogie de la morale
« Je considère la mauvaise conscience comme la profonde maladie dans laquelle l’homme devait sombrer sous la pression du plus radical de tous les changements qu’il ait vécu de manière générale – le changement qui survint lorsqu’il se trouva définitivement prisonnier de l’envoûtement de la société et de la paix. Ce qui se produisit de toute nécessité pour les animaux aquatiques lorsqu’ils furent contraint soit de devenir animaux terrestres, soit de périr, ce n’est pas autre chose qui arriva à ces demi-animaux adaptés avec bonheur à l’étendue sauvage, à la guerre, au vagabondage, à l’aventure, - d’un seul coup, tous leurs instincts se trouvèrent dévalorisés et "suspendus". Il leur fallait désormais marcher sur leurs pieds et « se porter eux-mêmes » là où auparavant ils étaient portés par l’eau : une pesanteur effroyable les écrasait. Ils se sentaient gauche pour les besognes les plus simples, pour ce monde nouveau et inconnu, ils n’avaient plus leurs anciens guides, les pulsions régulatrices, guidant inconsciemment avec sûreté, - ils en étaient réduits à penser, conclure, calculer, combiner des causes et des effets, ces malheureux, à leur « conscience », à leur organe le plus pauvre et le plus exposé à la méprise ! Je crois que jamais il n’a existé sur terre un tel sentiment de détresse, un tel malaise de plomb, - et ces instincts anciens n’avaient pas pour autant cessé d’un seul coup de poser leurs exigences. Seulement, il était difficile et rarement possible de faire leurs volontés : ils devaient pour l’essentiel rechercher des satisfactions nouvelles et comme souterraines. Tous les instincts qui ne se déchargent pas vers l’extérieur se tournent vers l’intérieur – c’est cela que j’appelle l’intériorisation de l’homme : c’est seulement ainsi que pousse en l’homme ce que l’on appellera par la suite son « âme ». Tout le monde intérieur, originellement mince, comme enserré entre deux peaux, a grossi et est éclos, a gagné en profondeur, en largeur, en hauteur à mesure que la décharge de l’homme vers l’extérieur a été inhibée. Les terribles remparts grâce auxquels l’organisation de l’Etat se protégeait contre les anciens instincts de liberté – les châtiments font partie au premier chef de ces remparts produisirent ceci que tous ces instincts de l’homme sauvage, libre, vagabondant se retournèrent, se tournèrent contre l’homme lui-même. L’hostilité, la cruauté, le plaisir pris à la persécution, à l’agression, au changement, à la destruction – tout cela se tournant contre le détenteur de tels instincts : voilà l’origine de la « mauvaise conscience »
La seconde considération intempestive
Il est toujours une chose par laquelle
le bonheur devient le bonheur :
la faculté d'oublier, ou bien en termes plus savants, la faculté de sentir les choses aussi longtemps que dure le bonheur en dehors de toute perspective historique. Celui qui ne sait pas s'installer sur le seuil de l'instant, en oubliant tout le passé, celui qui ne sait pas, telle une déesse de la victoire, se tenir debout sur un seul point, sans crainte et sans vertige, celui-là ne saura jamais ce qu'est le bonheur. Pire encore, il ne fera jamais rien qui rende les autres heureux...
Toute action exige l'oubli, de même que toute vie organique exige non seulement la lumière, mais aussi l'obscurité. Un homme qui voudrait sentir les choses de façon absolument et exclusivement historique ressemblerait à quelqu'un qu'on aurait constraint à se priver de sommeil ou à un animal qui ne devrait vivre que de ruminer continuellement les mêmes aliments. Il est donc possible de vivre, et de vivre heureux presque sans aucune mémoire, comme le montre l'animal, mais il est absolument impossible de vivre sans oubli.. Il y a un degré d'insomnie, de rumination, de sens historique au-delà duquel l'être vivant se trouve ébranlé et finalement détruit, qu'il s'agisse d'un individu, d'un peupe ou d'une civilisation.
Texte non publié
J'ai la chance d'avoir retrouvé la voie qui, après des millénaires d'erreur et d'errance, mène à un oui et à un non. J'enseigne le non à tout ce qui rend faible, qui épuise. J'enseigne le oui à tout ce qui rend fort, qui met de la force en réserve, qui suscite la fierté. Jusqu'à présent, on n'a enseigné ni l'un, ni l'autre. On a enseigné la vertu, le renoncement, la compassion, on a même enseigné la négation de la vie. Tout cela, ce sont valeurs d'épuisés.
Une longue réflexion sur la physiologie de l'épuisement m'a obligé à me demander jusqu'à quel point les jugements des épuisés ont pénétré dans le monde des valeurs. Le résultat auquel je suis parvenu fut aussi surprenant que possible.
Même pour moi qui était déjà familier de plus d'un monde inconnu, je trouvai que tous les jugements suprêmes de valeur, tout ce qui domine l'humanité, du moins l'humanité domestiquée, peuvent être ramenés à des jugements d'épuisés.
C'est à moi d'enseigner que le crime, le célibat, la maladie sont des conséquences de l'épuisement. Sous les noms les plus sains, j'ai démasqué les tendances le plus destructrices : on appelé Dieu ce qui affaiblit, enseigne et innocule la faiblesse. J'ai trouvé que l'homme bon était une forme d'auto-acquiescement de la décadence.
|


|
|